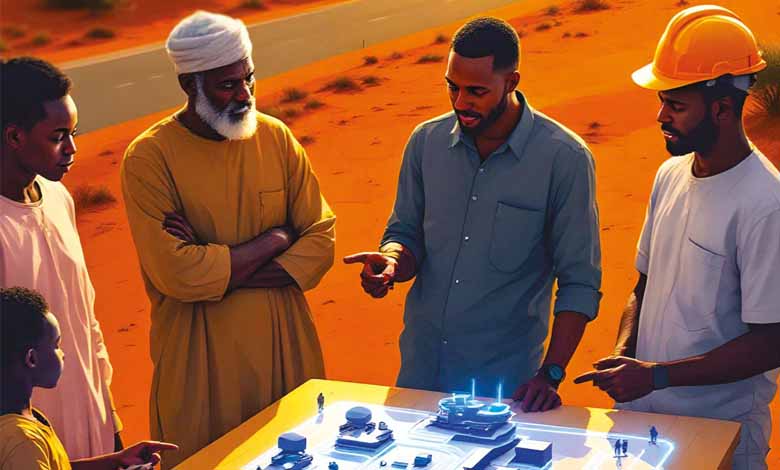
Fermeture et réhabilitation des mines, une fin de vie empreinte de complexité.
Tout comme le souffle de vie, l’exploitation minière suit un cycle, qui, à un moment donné, est appelé à s’arrêter. C’est une phase inévitable qui, pour le cas du Mali et de plusieurs pays d’Afrique, demeure un processus complexe à gérer pour plusieurs raisons. Entre une expertise faible dans la gestion des fermetures de mines, due à un manque d’expérience, et des montages financiers complexes, la fermeture et la réhabilitation des mines sont un enjeu qui mérite toute l’attention des acteurs étatiques et privés.
Le long terme comme finalité.
L’un des principaux reproches adressés aux gouvernements africains concerne leur manque de préparation à gérer l’ensemble du cycle de l’exploitation extractive. Au début de l’industrialisation des activités minières sur le Continent, les gouvernements ont opté pour des codes d’attraction qui visaient à installer les sociétés minières en leur réservant des mesures incitatives, parfois au détriment d’un développement durable. Étant donné que l’exploitation minière et pétrolière était le socle exclusif d’un développement économique rapide, les pays africains ont misé sur l’exploration et l’exploitation en faisant fi de la fermeture et de la réhabilitation des sites miniers.
Après 30 ou 40 ans d’exploitation sur le Continent, l’inévitable pointe à l’horizon. Les fermetures de sites miniers industriels s’intensifient, et les États tentent de suivre le rythme.
Parmi les défis à relever :
Le premier défi est celui de l’environnement. Selon le rapport de l’Organisation de coopération économique Asie-Pacifique, paru en 2018, les dépôts ouverts de résidus miniers peuvent avoir des conséquences sur l’environnement, par exemple une baisse de la qualité de l’eau, du sol et de l’air. Ce même rapport notait avec justesse qu’en fonction des caractéristiques du site, il est possible que la végétation mette du temps à se rétablir et que la biodiversité soit affaiblie de manière permanente.
Le second défi est bien celui des conséquences humaines d’une mauvaise gestion de la fin de vie d’une mine. Les ouvertures de mine laissées sans surveillance et les bâtiments abandonnés présentent des dangers physiques pour les personnes qui seraient tentées de les explorer. En Afrique du Sud, pays reconnu pour le nombre de fermetures de mines à la suite d’un épuisement de réserves dans un passé récent (plus de 6 000), les mauvaises expériences de fermeture de mine ont mis en lumière la reconversion de nombreux anciens employés en orpailleurs ou exploitants illégaux, souvent revenus sur leurs anciens sites.
Ce n’est pas l’apanage de l’Afrique.
D’autres défis, liés entre autres aux compétences humaines de gestion de l’après-mine, au financement du programme de fermeture et de réhabilitation, soulèvent des inquiétudes que résume bien Bonnie Campbell, universitaire et spécialiste des industries extractives : « Les fermetures de mines sont en quelque sorte révélatrices des limites du modèle minier en place. Et ce n’est pas l’apanage de l’Afrique. »
Le cas malien.
Il est vrai que le Mali reste un pays jeune dans l’histoire de l’exploitation industrielle des mines. Après une trentaine d’années, la fermeture n’était véritablement à l’ordre du jour. Ainsi, la mine de Kalana, entrée en production en 1985 avec la SOGEMORK, est toujours en activité avec la reprise par Endeavour Mining. La mine de Sadiola, qui a ouvert en 1996, continue ses activités de production avec Allied Gold.
Une des expériences marquantes, au Mali, d’une mine en phase de fermeture fut celle de Morila. Programmée pour 2013, la fermeture de Morila a cependant été repoussée plusieurs fois, en raison de réserves d’or plus importantes que prévu. Modèle de structuration, la phase de fermeture de la mine devait être marquée par une transition vers l’agrobusiness et une gestion environnementale rigoureuse. La mine a initié un projet d’agrobusiness pour assurer une reconversion économique durable. Un verger de 8,6 hectares a ainsi été mis en place, en plus d’une centrale électrique de 23 à 30 MW qui avait été maintenue pour une éventuelle exploitation locale.
Lancé en 2015, ce programme n’a pas connu de terme. L’État du Mali ayant décidé de poursuivre l’exploration et surtout l’exploitation de la mine avec de nouveaux acquéreurs.
La réforme engagée en 2023 par les autorités insiste sur un plan de fermeture et de réhabilitation. Cette exigence figure désormais dans les conventions signées en phase d’exploitation, et comprend l’ensemble des méthodes de démantèlement, de récupération des installations, ainsi que les travaux de réhabilitation à mener progressivement, pendant et après l’exploitation. Le Code de 2023 exige des sociétés d’exploitation qu’elles fournissent à l’État une garantie sous forme de compte séquestre couvrant la remise en état de la mine, destinée à assurer l’achèvement du plan de remise en état du site d’exploitation.
Il fait également du titulaire du titre minier le responsable civil des dommages et accidents qui peuvent être provoqués par les anciennes installations pendant une période de cinq ans après la fermeture de la mine.
Pour une fermeture et une réhabilitation réussies.
Selon le Forum intergouvernemental sur les mines (IGF), des activités de fermeture mal conçues ou irréalistes, qui n’assurent ni la stabilité physique, ni la stabilité chimique, ou qui exigent un entretien à long terme posent des problèmes pour l’approbation de la fermeture définitive. C’est dire qu’il est nécessaire pour les administrations publiques de définir avec clarté les critères d’achèvement afin que les exploitants des mines puissent démontrer le succès de leurs travaux de fermeture et que les autorités de réglementation puissent approuver et signer la fermeture.
Pour y arriver, le personnel de ces administrations doit être formé, outillé, et mis en capacité de suivre et d’évaluer efficacement les plans de fermeture proposés par les sociétés internationales. Également, ces phases ne devraient pas se faire sans la participation des communautés locales qui sont, in fine, les bénéficiaires d’un programme réussi de fermeture de la mine. Les travailleurs de la communauté, économiquement liés à la mine, doivent être assistés pour une reconversion vers d’autres secteurs économiques à fort potentiel.
Dans le cas de Morila, il était prévu que les villageois qui ont travaillé dans la mine aient un fonds pour le financement de micro-projets qu’ils auront eux-mêmes conçus et lancés. Ce financement, constitué du fonds social et des recettes issues de la vente de stocks récupérés sur le site, devait servir de rampe de lancement à un projet entrepreneurial pour lequel ils auront été préalablement formés. Le projet d’agrobusiness devait permettre à la communauté villageoise de remplacer la mine par une activité génératrice de revenus devant bénéficier à tous.
Instaurer la confiance par le dialogue.
Pour finir, l’État et les sociétés minières sont appelés à une coopération étroite sur cette phase. En effet, il n’est pas rare de constater que la fin de vie des activités minières intervient parfois dans un contexte conflictuel entre l’État et les firmes. La fermeture peut intervenir en cas de renonciation. Sans un dialogue des parties, l’État pourrait se retrouver à gérer, sans en avoir les moyens, une phase de fermeture. Ce dialogue doit instaurer la confiance entre le financement sécurisé par les sociétés via les comptes séquestres, et la bonne gouvernance des ressources mises à disposition de l’État et des collectivités.
Par le passé, la fermeture d’une mine était un processus qui n’était souvent assujetti à aucune mesure de contrôle. L’équipement et les matériaux qui n’avaient pas de valeur résiduelle étaient abandonnés sur place, les ouvertures de mine étaient laissées sans surveillance et, dans l’hypothèse la plus optimiste, on supposait que la nature allait reconquérir le site. Les répercussions que pouvaient subir les collectivités environnantes étaient considérées comme faisant partie du cycle naturel d’expansion et de ralentissement économiques.
La dynamique change, utilement, sur le Continent africain où plusieurs pays ont adapté leur législation et la réglementation en matière de fermeture et de réhabilitation des sites miniers.
Un fonds minier géré par l’État et les collectivités.
Dans cette conjoncture, les sites miniers artisanaux ou les sites d’orpaillage sont une seconde branche de ce défi de la fermeture et de la réhabilitation. Le Mali a fait le choix d’un fonds minier géré par l’État et les collectivités pour mettre en œuvre des programmes de réhabilitation de ces sites miniers.
Ce fonds, alimenté par 50 % de la redevance forfaitaire payée par les titulaires des permis d’exploitation artisanale et de carrière, devra permettre, selon le ministre des Finances du Mali, de prendre en charge les travaux de fermeture et de réhabilitation des sites miniers artisanaux en fin d’exploitation ou abandonnés.
Derrière chaque fermeture de site, c’est donc toute une chaîne d’acteurs qui doit apprendre à mieux préparer l’après.
Car quand la terre se referme, il faut que l’avenir ait déjà pris racine.
Par Baba Sakho.




